ACCUEIL NXI GESTATIO
POINT [ D’ ] ORIGINE
[OBSERVATOIRES DE L’INACCESSIBLE, ÉTUDE NO 9]
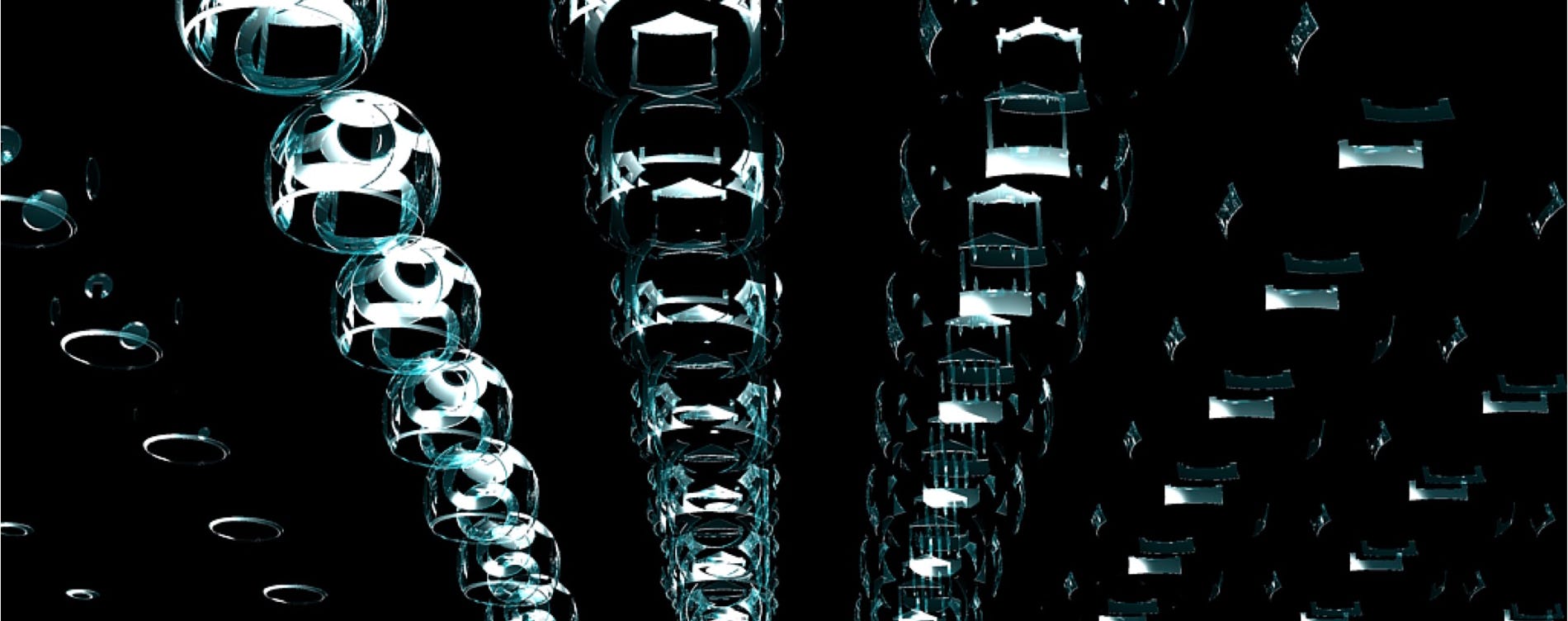
ANCRAGE THÉORIQUE DU PROJET
De l’harmonie des sphères aux harmoniques sphériques
Point (d’) origine» est un projet de recherche-création issu du programme des Observatoires de l’Inaccessible. Il se décline en un ensemble de projets situ, conçus dans l’idée d’une évidence d’usage et d’une simplicité d’utilisation, prévus pour être présentée en des lieux accessibles à tous les publics. Une première version de cette installation s’est déroulée de juillet à octobre 2017 dans la cathédrale gothique de Mende, en Lozère, dans le sud de la France.
Tant le dispositif que la musique produite reposent sur plusieurs années de travail théorique, de recherche et de développement, qui se déploient eux-mêmes sur différents niveaux. Le présent texte a pour but d’en résumer les grandes lignes, et de montrer comment l’installation en représente à la fois le point de convergence et la synthèse.
Le projet émane d’un constat : toute architecture, de la plus misérable à la plus somptueuse, est une petite cosmologie, ce qui transparaît de deux façons. La première concerne la charge symbolique qui imprègne tout édifice occupé par des êtres humains. Au-delà de ses fonctions propres, toute construction, même la maison la plus banale, s’enracine dans un vaste imaginaire, lui-même ancré dans un ensemble de questions pour lesquelles nous n’avons pas de réponse, et qui portent sur la vie, les origines, le sens. Le pavillon de banlieue européen, le bungalow nord-américain, sont souvent cités comme exemples de la banalité, voire de la médiocrité la plus affligeante. Pourtant, comme toute maison, ils abritent les gestes et les actes essentiels à la perpétuation de la vie : manger, dormir, se reproduire, évacuer. En cela, ils concrétisent dans le bois, la brique ou la pierre une affirmation qui ne va pas de soi, selon laquelle la vie des êtres humains mérite d’être perpétuée. Peu de gens s’éveillent le matin en se demandant pourquoi ils se lèveraient plutôt que de rester au lit à se questionner sur la nécessité de faire quelque chose, et à éventuellement mourir par manque de réponses, après avoir conclu que la vie en général, et la leur particulier, est inutile. Peu de gens s’attablent devant un repas pour se lever sans rien manger, parce qu’ils se sont posés des questions similaires. Peu également s’interrogent sur la nécessité de fonder une famille, et sur l’origine profonde de la chaîne d’événements qui, depuis la naissance de l’univers, a généré ce moment où ils décident de se reproduire et de prolonger cette chaîne. Se nourrir, respirer, se laver, parler avec ses semblables, tous ces gestes du quotidien flottent en un fragile équilibre sur un gouffre de questions vertigineuses, qu’il est prudent de garder à distance pour pouvoir agir et vivre au quotidien. C’est ici que la maison joue un rôle fondamental : sa banalité, la quotidienneté des routines qu’elle induit, ses aspects les plus ordinaires, deviennent les garde-fous qui protègent les téméraires contre le danger de questionnements sans fin sur les origines, la finalité, l’existence. De ce fait, elle les dessine en négatif : suspendue entre la matérialité biologique du monde et l’immensité des territoires symboliques qu’elle révèle, la maison la plus ordinaire parle aux dieux.
La deuxième connexion cosmologique passe quant à elle par un ensemble de relations analogiques souvent faciles à percevoir. À chaque époque, il est possible d’associer plusieurs, et parfois la plupart, des éléments d’un édifice aux éléments majeurs de la cosmologie qui prévaut à son époque et dans sa culture. Parfois subtiles et parfois évidentes, ces associations apparaissent encore une fois sur tous les types d’architecture, profanes et religieuses, nomades et sédentaires, et à toutes les échelles L’exemple de la tente touarègue est à ce titre éloquent : si à première vue rien ne semble connecter cet habitat d’apparence très simple à des échelles d’ampleur cosmologique, un examen plus approfondi révèle sa filiation avec toutes les échelles du monde. Un simple plan diagrammatique révèle déjà une orientation selon les quatre points cardinaux, et nous apprend qu’en dépit de sa structure carrée, son nom en langue touarègue signifie « cercle ». Cette connexion avec les quatre orients est d’ailleurs bien plus profonde. La porte ouvre toujours vers l’ouest. Les aires situées en regard de chaque flanc de la tente ont toutes des caractéristiques différentes. L’aire occidentale est ouverte sur le monde et la rencontre ; il s’agit de l’aire des repas, de la cérémonie du thé, des réceptions. À l’opposé, l’aire orientale, la seule qui soit aveugle, est l’aire du recueillement et de la prière. L’aire septentrionale est vue comme maléfique ; au crépuscule s’y regroupent des être surnaturels, les kel-esuf, « ceux de la solitude ». On ne s’y tient jamais. L’aire méridionale est au contraire bénéfique : c’est l’aire de la chance (baraka) ; c’est là que les mères s’installent pour donner naissance à leurs enfants.
On remarque ici une coïncidence entre cette orientation et celle de la plupart des églises chrétiennes : l’ouverture au monde profane, la réception, la rencontre, se fait sur l’aire occidentale, en analogie avec le parvis d’une église orientée; la prière et le recueillement, et donc le dialogue avec les êtres divins du cosmos religieux de la tribu, s’effectuent du côté oriental, qui est complètement fermé, comme le chevet d’une église. Les aspects bénéfiques et maléfiques des aires septentrionale et méridionale établissent quant à eux une connexion avec un premier niveau supérieur d’échelle, à savoir celui du territoire. Ils reflètent la position géographique relative de l’habitat touareg, pour qui « au sud s’étendent les contrées fertiles d’où provient le mil ; au nord ne règnent que le désert et la faim ». L’intérieur de la tente est lui aussi orienté : au nord se trouve l’aire masculine, celle de l’époux. C’est là où il dort ; c’est par là qu’il entre le jour des noces. Le sud est l’aire féminine, le domaine de l’épouse, et le lieu de son entrée dans la tente en ce même jour. Ainsi la tente détermine non seulement les lieux des époux, mais l’orientation de la trajectoire qui conduit à leur rencontre au centre de la tente : « Lorsque Dieu créa le monde,
il plaça Adam au nord et Eve au sud.
Ils se mirent alors en marche, lui vers le sud,
elle vers le nord, jusqu’à se rencontrer
au centre du monde». Le jour des noces, la marche nuptiale des époux l’un vers l’autre récapitule la rencontre et l’accouplement du couple originel, ceux d’où origine toute vie humaine. Le centre de la tente, dont le nom touareg, « ehen », signifie « les noces », se transforme pour ce moment précis en centre symbolique du monde. Il est à noter que ;es tentes de certaines tribus touarègues, notamment au Niger, possèdent un pilier central fait d’une branche vertical, un axis mundi , qui traverse un morceau horizontal de bois plat, dont le nom évoque l’acte sexuel, sans doute par analogie immédiate. Ces échos cosmologiques se répercutent jusqu’aux échelles célestes : chacun des quatre piliers de la tente porte en effet le nom d’une des étoiles du carré de Pégase, constellation évidente dans le ciel du désert. Selon les targuis, Dieu a placé ces étoiles sur la voûte des cieux pour rappeler en tout temps que le ciel tout entier est une gigantesque tente, soutenue par quatre immenses piliers placés très loin, hors de portée humaine, au quatre points cardinaux.
Pour décrire l’ensemble des connexions symboliques, poétiques et analogiques qui relient l’architecture au cosmos et au territoire, nous utiliserons, pour des raisons qui seront clarifiées dans les paragraphes suivants, l’expression « connexion harmonique ». Il est difficile de trouver un édifice qui ne présente pas une telle connexion, à un degré ou un autre. Si la création de Point (d’) origine a eu lieu dans une cathédrale, c’est bien sûr que cet édifice est lui aussi, un écho cosmologique, tant par sa charge symbolique que par un ensemble de faisceaux analogiques. Pour préciser cette connexion, nous allons nous pencher sur une séquence qui nous ramènera plus de 2500 ans dans le passé. Elle nous permettra de récapituler brièvement les transformations qui ont conduit à la forme unique de la cathédrale, et de voir comment elle a évolué par la suite. De plus, grâce à quelques exemples choisis, nous verrons comment les transformations successives de l’image du monde, et des modèles du cosmos qui lui sont associés, se sont répercutées dans les architectures des époques correspondantes.
2 – Le cosmos harmonique : l’être et le monde
La connexion harmonique se manifeste selon des formes extrêmement différentes selon les époques et les cultures. Même si elle est souvent évidente, elle se dissimule parfois sous des jeux de permutations et de substitution qui demandent à être élucidés pour en saisir toute la portée. Une note de précaution toutefois : même si plusieurs des paragraphes qui suivent se basent sur des faits scientifiquement avérés, il est essentiel de garder à l’esprit que la connexion harmonique n’est ni une théorie scientifique, ni un fait historique systématiquement avéré, mais bien une mise en relation poétique au sens étymologique du terme, c’est-à-dire porteuse de possibilités créatrices. L’histoire de l’architecture montre en effet que la création architecturale en général ne s’embarrasse pas de vérités historiques ou scientifiques, sauf lorsqu’elle adopte cette posture dans le cadre d’un scénario précis de conception : la réussite d’un projet d’architecture ne dépend que très peu du scénario qui l’engendre. Bien des pièces majeures s’ancrent dans des mythes, des légendes et des fictions sans correspondance aucune avec l’histoire, ni avec la réalité des faits. Les exemples qui suivent ont été regroupés dans le seul but de dévoiler certaines analogies formelles avec la cosmologie des époques et des lieux qui les ont vu naître.
Les modèles de la structure du cosmos, comme on le sait, se sont considérablement transformés depuis la Grèce antique jusqu’à aujourd’hui. Le cosmos de l’Antiquité est essentiellement constitué d’un système planétaire, souvent centré sur la Terre ; et qu’une figure abstraite commune à tous les systèmes anciens est celle de la sphère (ou du cercle). Il y a 2500 ans, le cosmos qui prévalait en Grèce plaçait la Terre en position centrale ou quasi-centrale ; les planètes tournaient autour de la Terre selon des orbites, simples ou complexes, selon les modèles, mais toujours rapportées à des combinaisons de mouvements circulaires ; au-delà des planètes se trouvait la sphère des étoiles fixes. Dans un tel système, les mouvements planétaires, en particulier ceux des planètes extérieures (Mars, Jupiter, Saturne), défiaient toute tentative de prédiction, d’où leur nom grec de planetai, ou astre errant. Cela leur a valu le statut de messagers des intentions divines : leur comportement traduisait les intentions des dieux, et permettait aux oracles de toutes les catégories d’énoncer des prédictions sur les événements futurs.
Dans la lignée d’Anaximandre de Milet, dont les descriptions du monde sont parfois sidérantes de modernité, la science grecque a constamment cherché à débarrasser la nature de causalités surnaturelles pour trouver aux phénomènes naturels des explications naturelles. Les mouvements planétaires devaient à ce titre être rapportés à des régularités géométriques qui permettraient de prédire leurs trajectoires, sans aucun appel au hasard ou aux velléités du panthéon céleste. De cette injonction sont nés les extraordinaires modèles du système solaire basés sur la notion d’épicycle, parfois stupéfiants par leur sophistication, dans lesquels les planètes orbitaient autour de petits cercles dont les centres tournaient autour de la Terre en des cercles appelés « déférents ». Les évolutions successives de ces modèles les ont vu s’enrichir d’épicycles et de mouvements circulaires de plus en plus nombreux et complexes, afin de coller au plus près des observations, sans jamais complètement y parvenir. Ces tentatives ont servi de base à la cosmologie occidentale durant près de 2000 ans. Bien que loin d’être débarrassé de tout a priori symbolique, le modèle des épicycles est l’un des premiers, sinon le premier modèle du monde à faire appel à la notion d’harmonique. Conceptuellement très différente de celle d’harmonie, cette notion ne sera formalisée qu’au cours du XVIIIe siècle par le mathématicien Joseph Fourier. Comme nous le verrons plus loin, elle est devenue aujourd’hui un principe essentiel pour la description de la réalité physique.
Comme dans le cas de la tente touarègue, le lien entre cosmos et architecture dans la Grèce antique se déploie sur deux niveaux. Le niveau symbolique fait appel à la notion de proportion, une notion très vaste dont l’influence sur le monde antique est impossible à surestimer. Le niveau analogique associe directement, comme il se doit, des éléments de l’édifice antique à des éléments du monde céleste.
La notion de proportion, dans le monde grec, se rapportait exclusivement à des rapports de nombres entiers, eux-mêmes pourvus d’une charge symbolique d’ampleur mythique. Certains rapports particuliers, tels que la moitié ou le double, les deux tiers ou les neuf huitièmes, portaient des noms, à la manière des nombres : sesquialtère, diatessaron, diapason. Une abondante littérature a tenté de cerner l’origine de ce statut ; l’hypothèse la plus vraisemblable la situe au niveau de l’harmonie musicale. D’une part, les divisions de la corde vibrante d’un instrument ancien, appelé « monocorde », produisaient des sons variés, de plus en plus aigus à mesure que les sections de la corde diminuaient en longueur. Les combinaisons de certaines divisions produisaient des sons singuliers, soit par leurs similitudes, soit par le fait qu’ils étaient agréables à l’oreille (« harmonieux »). Les proportions des longueurs correspondantes étaient de ce fait considérées comme particulières. D’autre part, plus le nombre de divisions augmentait, plus la note émise montait en fréquence. L’état de la connaissance chez les grecs ne laissait supposer aucune limite théorique à cette ascension : les divisions de la corde pouvaient théoriquement produire des sons infiniment aigus, esquissant un passage entre le monde fini des hommes et le monde infini des êtres surnaturels.
La morphologie de ces mêmes êtres, les dieux qui résidaient au sommet de l’Olympe, était semblable à celle des hommes, mais les proportions de leurs corps étaient, nécessairement, basées sur des rapports de nombres entiers. De ce fait, le corps idéal pour un être humain devait adopter ces mêmes proportions. La mythologie grecque inversait l’ensemble du propos : le corps humain devenait le moyen par lequel les dieux transmettaient aux hommes leurs propres proportions, qui par la suite devaient se répercuter sur tous les aspects de la vie terrestre. De cette hégémonie de la proportion est né l’injonction d’harmonie pour tous les aspects du monde.
On notera ici la parenté étymologique, qui ne saurait être le fait du hasard, entre les mots « harmonie » et « Olympe », tous les deux issus d’une racine proto-indo-européenne indiquant le surplomb : séjour des dieux, l’Olympe est le lieu d’ou rayonne, par le biais des proportions, l’harmonie qui régit le monde des humains. On retrouve ces proportions à des degrés divers au niveau de la loi, de l’économie, des phases de la grossesse… et bien sûr de la musique, dont les gammes découlent – et pour cause – de ces mêmes proportions, ainsi que de l’architecture. Le temple grec, lieu du contact entre les mondes, adoptera de facto ces proportions, en un rappel constant aux populations terrestres de la structure du cosmos dans lequel ils vivent. L’harmonie régentait le monde, et sa puissance se déclinait selon trois volets : d’une part, elle fournissait une description de l’Univers ; d’autre part, elle donnait une liste d’instructions à valeur d’injonctions sur les mesures à prendre pour atteindre le bon ordonnancement du monde terrestre et des affaires humaines ; enfin, elle se présentait comme une messagère entre les mondes, transmettant aux hommes les informations des mondes célestes que les dieux voulaient bien leur communiquer. Il faut noter que l’unité de mesure utilisée pour mettre ces proportions en œuvre, à savoir le pied antique, est également tirée de la morphologie d’un être surnaturel, à savoir le demi-dieu Hercule : l’architecture de l’époque est à la fois dimensionnée et proportionnée par des éléments de nature cosmique.
Au niveau analogique, le temple grec se présente comme une inversion topologique du cosmos, en une forme d’antisymétrie qui révèle à la fois les connexions et les différences entre les mondes. Le plan de temples circulaires, ou tholos, illustre bien ce constat, du fait de la similitude entre les cercles du plan et les cercles célestes ; mais la topologie globale reste la même dans le cas d’un plan rectangulaire. La cosmologie grecque place le monde des hommes en son centre ; puis se trouvent les premiers niveaux du monde céleste, zone intermédiaire où règnent les planètes ; enfin se trouve la sphère des fixes, monde céleste habité par les êtres divins. Le temple grec inverse la séquence : les hommes se trouvent en périphérie ; puis se trouve la zone intermédiaire, celle des colonnades et des murailles ; au centre se trouve le « saint des saints », région accessible aux prêtres uniquement, lieu de contact avec le monde surnaturel des dieux. Ce tout petit lieu, aux dimensions physiques très restreintes, est immense au niveau symbolique : il représente à lui seul l’ensemble du ciel. Tout se passe comme si l’ensemble du ciel s’y projetait, à la manière d’une perspective sphérique, ou d’un miroir sphérique dans le reflet lequel tous les points de l’univers, si éloignés soient-ils, trouvent les points qui leur correspondent ; et où l’infini de la voûte céleste se trouve entièrement concentré dans le seul point central de la sphère.
Quelque mille cinq cents ans après les premières cosmologies grecques, les églises romanes, ainsi que les abbayes de la même époque, reflètent la structure du cosmos d’une façon entièrement différente, correspondant aux profonds bouleversements des mondes célestes suite au passage à l’ère chrétienne. Le plan de la première basilique Saint-Pierre de Rome permet d’en distinguer les éléments essentiels.
L’une des différences primordiales, peut-être la plus importante, entre le ciel polythéiste des grecs et celui, monothéiste, des chrétiens, et que le second est accessible : il existe des situations et des circonstances bien établies par lesquelles les êtres humains peuvent devenir des êtres célestes, par béatification ou canonisation. Ces circonstances consistent en parcours de vie jalonnés d’épreuves et d’étapes initiatiques qui distingueront au long cours ceux qui les mènent à terme et méritent d’accéder au monde divin. Si les justes accèdent au paradis, les bienheureux et les saints deviennent eux-mêmes des êtres célestes, de qui l’ont peut demander par la suite l’intercession par la prière. Le plan ci-dessous illustre deux étapes de l’architecture romane qui reflètent ce modèle. Dans le premier, l’on franchit d’abord le massif occidental (ou westwork), encore connecté au monde des hommes, mais qui ouvre sur le parvis, ou paradis, les deux termes étant équivalent. Ensuite s’amorce la traversée de la nef, parcours jalonné d’étapes symbolisées par les travées, pour arriver au saint des saints , matérialisé en ce temps-là par le tabernacle, maison de Dieu au cœur de l’édifice et lieu du passage vers l’infini du monde céleste.
Dans le second plan, adopté par la très grande majorité des édifices religieux romans et gothiques, le parvis est déporté à l’extérieur ; le massif occidental, séparé de l’extérieur par un porche, jouxte maintenant la nef. L’accès au paradis devient moins restrictif : le seuil se situe au moment où s’amorce le chemin vers le ciel. Le point essentiel de ce parcours est qu’il est à double sens. La nef de l’église devient le passage par lequel le monde des hommes et le monde divin communiquent et s’infiltrent l’un dans l’autre, une situation impensable dans l’antiquité grecque.
Nous avons évoqué plus haut la coïncidence entre les orientations spatiales de l’église chrétienne et celles de la tente touarègue. Dans les deux cas, les événements sociaux, les rencontres, les célébrations, se déroulent devant l’entrée principale, située à l’ouest. Le côté est, auquel correspond le chevet de la plupart des églises chrétiennes (toutes celles dites « orientées »), est aveugle dans les deux cas : c’est l’endroit le plus sacré, celui où se déroule la prière chez les targui, celui du chœur, des reliques et des déambulations de l’église chrétienne. Cela n’est pas un hasard, du fait que la tente décrite ci-dessus provient de targuis ayant adopté cette même religion, mais cela illustre le fait que la connexion harmonique se retrouve à toutes les échelles de l’architecture, en des lieux et des époques extraordinairement variés. Une autre similitude, plus primordiale encore, se manifeste. On se rappellera que le centre de la tente touarègue symbolise le lieu de la noce, de l’accouplement, et donc de l’origine et de la perpétuation de la vie. La chrétienté a constamment et obstinément fait l’impasse sur la composante sexuelle du symbolisme des cathédrales, composante qui, à la lumière de la psychanalyse et des premiers travaux sur l’inconscient, s’est révélé flagrant. À l’image de la conception du Christ, débarrassée de tout ce qui a trait à la sexualité ou au désir, le chœur de la cathédrale, lieu symbolique de la vie perpétuelle, voile de façon obsessionnelle et névrotique tous les aspects biologiques ou corporels de la reproduction humaine.
La réinterprétation de Vitruve par Alberti vers 1440, moment fondateur de l’architecture de la Renaissance, correspond chronologiquement à l’introduction d ‘éléments nouveaux tant en architecture que dans les arts, discipline dont ce même architecte avait également traité quelques années auparavant dans son ouvrage De Pictura. Elle marque le début d’une période hybride, oscillant entre un ancien monde encore dominé par les forces divines et les êtres célestes, et un monde nouveau dans lequel, progressivement, les humains réapprivoisent, après une éclipse de 2000 ans, l’idée d’une nature explicable par des phénomènes naturels, eux-mêmes explicitables par la puissance de la raison. Cette dualité se manifeste dans plusieurs œuvres picturales et architecturales. On la retrouve par exemple dans un tableau comme les Noces de Cana, de Véronèse, initialement composé pour le réfectoire de la basilique San Giorgio Maggiore, à Venise, et actuellement exposé au Louvre. La composition se caractérise par une double perspective, qui deux points de fuite. L’un correspond à la figure du Christ, l’autre se situe en plein ciel. Aucun de des deux ne domine, et aucun ne correspond au centre du tableau, comme un regard rapide le laisserait supposer.
Veronèse ne pouvait ignorer les règles de la perspective, précisément énoncée dans le De Pictura. Elles démontrent géométriquement que le point de fuite est le lieu de l’infini : le tableau suppose donc l’existence simultanée de deux infinis, le premier au niveau du Christ lui-même, et donc de la religion ; le second au niveau du ciel, en une précoce évocation de l’infini céleste, relevant donc de la nature. Dans la zone indéterminée entre les deux, précisément à mi-chemin, se trouve un plat dans lequel on découpe un agneau, décrit par les exégètes comme l’agneau sacrificiel, qui évoque la double nature du Christ et manifeste la nécessité d’adjoindre les considérations terrestres – la nourriture – aux considérations célestes – la religion – pour atteindre à l’appréhension pleine et complète du réel.
On retrouve tout au long des siècles suivants les répercussions architecturales des différentes étapes qui ont mené au cosmos contemporain. L’un des principaux impacts du système héliocentrique de Copernic a été de déloger l’habitat des humains, et par conséquent l’être humain lui-même, de sa place singulière et centrale au centre de l’univers. Les dimensions du ciel, sans devenir encore clairement infinies, devaient êtres multipliées par des facteurs colossaux pour s’inscrire dans le nouveau modèle. Par ces opérations, la Terre sortait de son immobilité et devenait un planetai comme les autres, transformant les humains eux-mêmes en errants perpétuels (wanderers) au sein d’un espace qui, au fil des siècles, devenait de plus en plus immense et insaisissable : l’ensemble du ciel, plutôt que la seule Terre, devenait l’habitat de l’homme et de ses errances.
Publié en 1543, le système copernicien, qui circulait déjà sous le manteau depuis 1513 et connaissait une certaine diffusion, a précédé de peu la construction de la villa Almerico Capra dite « Rotonda » (1566-1571) par l’architecte italien Andrea Palladio. L’auteur explique la symétrie parfaite de l’architecture par le lieu de son implantation. Situé au sommet d’une colline, l’édifice jouit d’un panorama périphérique qui justifiait selon lui la mise en œuvre de quatre façades identiques. Sans réfuter cette intention, il convient de voir dans ce plan centré, l’un des premiers à refaire surface depuis les ères paléochrétiennes et byzantines, une première figuration sur Terre du nouveau cosmos ; figuration qui de surcroît concerne pour la première fois non plus un temple ou une église, mais bien un édifice domestique, et donc profane. L’emploi d’une coupole sur une maison, une première également dans le monde occidental, ne fait que renforcer l’image du nouveau cosmos : sous ce ciel de pierre se déroulent à présent les errances des humains, dont l’habitat a été délogé du centre du monde. Si l’on rajoute que l’architecture par elle-même n’évoque aucune fonction domestique, mais se rapproche, par sa monumentalité et sa morphologie, d’un édifice de type mausolée ; que l’orientation diagonale par rapport aux points cardinaux détermine une division du paysage en quatre quartiers auxquels font face les quatre façades, une configuration que l’on retrouve dans le donjon original du château de Chambord (complété en 1547), auquel aurait participé Léonard de Vinci, et dont le plan présente également une symétrie très forte au symbolisme manifestement cosmique ; il est légitime de supposer qu’ici encore, comme dans la tente touarègue et l’église médiévale, l’architecture, ancrée dans le territoire, se propose à la fois comme écho et modèle du nouveau cosmos en cours de constitution.
On retrouve une coïncidence chronologique semblable entre l’introduction de l’ellipse comme figure céleste dans l’ouvrage Astronomia Nova de Kepler en 1609, qui présentait les deux premières lois portant le nom de l’astronome (la troisième a été publiée dix ans plus tard), et l’apparition de l’ellipse dans l’architecture occidentale. Parmi les exemples majeurs, il faut mentionner l’esplanade de la basilique Saint-Pierre de Rome, conçue par Le Bernin. Il est en effet difficile de supposer que le Bernin, homme instruit et cultivé, ait ignoré les travaux de Kepler. Cela l’aurait, certains auteurs, plongé dans un dilemme au moment de concevoir l’esplanade. Souhaitant en faire l’évocation symbolique d’un cosmos dominé et illuminé par la basilique, il aurait pu la concevoir selon l’ancienne cosmologie et lui donner un plan circulaire, une position sans risque pour lui, mais inconfortable pour l’église : s’il la dessinait ainsi, l’architecture de ce lieu hautement symbolique deviendrait bientôt obsolète par rapport aux connaissances de l’époque. Si par contre il la dessinait selon la nouvelle cosmologie, il plaçait juste devant la basilique - et les appartements privés du pape - des figures qui resteraient hérétiques pendant des décennies, une insulte flagrante qui aurait pu le conduire directement au bûcher. Il éluda la question en déclarant que la colonnade représentait deux bras ouverts, destinés à accueillir la foule des fidèles, une affirmation réfutée par la plupart des exégètes sur la base des dessins accompagnant ses textes, et maintenant considérée comme un alibi. Plusieurs indices pointent au contraire vers une figure cosmologique : l’obélisque égyptien central provient d’Héliopolis, la cité du Soleil ; l’ouverture de la colonnade et les deux bras trapézoïdaux définissent des angles qui correspondent au lever du soleil aux dates des solstices ; le positionnement des fontaines aux foyers de l’ellipse correspond aux positions possibles du Soleil dans le nouveau système. L’emploi ultérieur de l’ellipse à Saint-André-du-Quirinal (1661-1670) a servi référence à de nombreuses églises des époques baroque et maniériste, généralisant à l’architecture sacrée l’emploi de cette nouvelle figure du ciel.
Les siècles suivants ont vu, de la même façon, s’établir des correspondances formelles parfois très précises entre cosmos et architecture. Après la publication par Newton de son ouvrage Principia Mathematica dans lequel il énonce pour la première fois la loi de la gravitation, se dégage l’image nouvelle d’un univers gigantesque dans lequel des sphères célestes suspendues dans un espace aux dimensions gigantesques tournoient majestueusement sans être soutenues par rien. Très peu de temps après, les architectes dits « révolutionnaires », qu’il serait plus approprié d’appeler « Newtoniens », publient des gravures d’édifices aussi utopiques que gigantesques, aux dimensions encore jamais rencontrées en architecture. Pour la première fois, ils investissent le motif géométrique de la sphère complète, et pas seulement de la demi-sphère, représentée par le dôme ou la coupole, ou du quart de sphère, comme la voûte en cul-de-four.
De surcroît, Newton a posé pour la première fois l’hypothèse d’un espace infini, conclusion qui découlait logiquement de sa théorie : des astres situés dans un espace fini devraient nécessairement s’attirer les uns les autres, et s’écraser au bout du compte les uns sur les autres. Parmi les premières évocations architecturales d’un espace infini, il faut citer les dessins de Nicolas Durand, professeur à l’école Polytechnique de Paris, auteur d’un traité dans lequel les plans des édifices sont déterminés par le cloisonnement d’un ensemble de mailles choisies sur une grille qui s’étend au-delà de l’édifice, sans limite apparente. Les lieux de l’homme deviennent des cellules closes au sein d’un univers qui s’étend au-delà de l’imaginable. La grille elle-même est un symbole fort : elle évoque le système cartésien de coordonnées établi quelques décennies auparavant par Descartes. Cet outil conceptuel, grâce auquel Newton a pu dériver ses lois, est de fait un système de repérage : théoriquement extensible jusqu’à l’infini, il attribue une adresse à chaque point de l’espace, déterminant instantanément le temps et la distance nécessaire à le rejoindre. Il annonce pour la première fois l’image aussi mythique qu’inquiétante d’un monde dans lequel il devient impossible de se perdre. De la même façon que les nouvelles lois physiques unifient la description d’un grand nombre de phénomènes, réduisant la complexité du monde à un ensemble de principes simples, l’architecture de Durand unifie toutes les architectures en les réduisant aux combinaisons des cellules d’une grille parfaite.
Tout au long de ce parcours cosmologique, c’est l’ensemble de la structure de l’Univers qui évolue, au niveau géométrique comme au niveau topologique. Un motif persiste néanmoins : celui du cercle et de la sphère ; mais son statut se transforme. Si les autres coniques (ellipse, parabole, hyperbole) qui caractérisent l’univers Newtonien étaient bien connues des géomètres grecs, le cercle lui-même était un symbole de perfection et possédait de ce fait un statut privilégié, alors que son statut pour la science moderne dépend de la façon dont on le considère. Pour les astronomes, il n’est plus qu’un cas très rare et particulier de l’ellipse, elle-même un cas particulier de conique. Depuis la naissance de la géométrie projective avec Desargues, toutes ces formes deviennent des variations d’un seul et même motif : toutes les coniques sont des cercles vus depuis différents angles, et selon différents points de vue.
Par rapport au cercle, et du point de vue cosmologique, l’ellipse pose problème : elle possède trois points caractéristiques, le barycentre et les deux foyers, qui tous peuvent prétendre au statut de « centre », soulevant la question cruciale de savoir qui, et ce qui, se trouve au centre d’un monde dont cette courbe est devenue le modèle. De fait, l’histoire des cosmologies, autrement dit l’histoire des histoires de l’Univers, est l’histoire des déplacements du centre du monde. Ce point, hautement symbolique et dont l’existence même n’a jamais été remise en question pendant plus de huit mille ans, a longtemps oscillé à proximité de la Terre, oscillant alternativement de la surface d’une Terre plate au centre d’une Terre sphérique en passant par un point de l’espace vide, effectuant de brefs séjours aux Enfers mythologiques avant de s’envoler vers le Soleil, puis de se pulvériser, avec Galilée d’abord et Einstein ensuite, sur tous les points de l’Univers : depuis le modèle relativiste, aucun endroit ne peut plus prétendre au statut de centre d’un monde qui, depuis chacun de ses points, semble gonfler également dans toutes les directions. Le seul point qui puisse être distingué est celui où je me trouve à un instant donné, ce qui pourrait sembler présomptueux si l’on ne rajoutait immédiatement qu’il en va de même pour chaque être humain – et sans doute pour chaque être vivant. À chaque instant, je me trouve au centre d’une sphère perceptuelle, celle sur laquelle se projettent tous les objets, les phénomènes et les événements du monde ; c’est par elle que je repère le monde, c’est elle qui détermine à chaque instant la façon dont je vais interagir avec lui. Elle se déplace constamment avec moi et propose dans toutes les directions des horizons qui s’ouvrent et se referment selon mes déplacements. Une façon métaphorique de s’en convaincre est de réaliser qu’en chacun des lieux que je parcours, le zénith, soit le sommet de la voûte céleste, se trouve toujours exactement au-dessus de moi : il devient en quelque sorte le pôle nord de ma sphère perceptuelle.
La naissance de la science moderne à partir des Lumières a mis un terme aux prétentions de la connexion harmonique à dire quoi que ce soit de sensé à propos du cosmos, et a complètement éliminé la proportion humaine de sa description, éliminant jusqu’aux références corporelles (pied, pouce…) dans les unités de mesure du monde, déterminées successivement, depuis la Révolution, à partir de la taille de la Terre, à partir d’une référence atomique, et depuis la vitesse de la lumière. Qu’en est-il de la musique, quatrième élément ordonnateur de la tétrade antique ? Elle n’a pas échappé à ces transformations : la mise en ordre de l’Univers et de l’architecture s’est accompagnée d’une régularisation analogue dans plusieurs autres domaines, notamment le texte écrit et la notation musicale, sur lesquels nous n’élaborerons pas ici. Il faut toutefois noter que la normalisation finale de la portée musicale s’est déroulée entre 1650 et 1750, et que la description des sons en termes de fréquences a connu une formalisation mathématique précise qui s’est complétée en 1863 avec le travail de Helmholtz. Dès le XVIIIe siècle, la portée propose dans le domaine du son et de l’acoustique un modèle descriptif dont plusieurs aspects sont au moins aussi précis que les nouveaux modèles scientifiques du cosmos : chaque note musicale de la partition classique possède une adresse précise dans un espace temps-fréquence, au sein duquel sa durée est également déterminée. Il n’est pas inintéressant de noter que ces « équations musicales » de la musique sont apparues moins d’un demi-siècles après la publication par Newton de l’ouvrage Philosophiæ Naturalis, dans lequel il formule pour la première fois les lois de la gravitation.
La grande victime de cette mise en ordre est l’harmonie proprement dite, ainsi que les systèmes de proportions qui la fondent. La virulence des écrits de certains auteurs de l’époque (Burke, Hume…) ne laisse aucun doute sur la volonté farouche des nouveaux scientifiques d’exterminer toute trace de ce qui apparaît comme un ensemble de superstitions issues de temps obscurs.
Pourtant, l’un des éléments du cosmos harmonieux, directement issu de la notion de proportion, a réussi à traverser cette phase, pour se positionner aujourd’hui comme élément primordial des descriptions scientifiques du monde. Son nom même traduit son origine : il s’agit de l’harmonique, qui, d’ascendance musicale, est maintenant utilisée pour décrire les composantes élémentaires de phénomènes complexes, et ce dans tous les domaines : son, lumière, images, formes… On doit cette théorie au physicien et mathématicien Joseph Fourier, qui l’a dérivée en analysant les phénomènes de propagation de la chaleur. Bien connue de tous les spécialistes et compositeurs de la musique électronique, elle postule que tout signal sonore complexe et périodique, comme celui d’une clarinette, d’un grand orchestre ou d’un appareil mécanique, peut être décomposé en un ensemble de signaux simples. Dans le cadre de l’onde sonore, ces derniers correspondent aux fonctions trigonométriques, sinus et cosinus ; mais la décomposition peut se faire sur toute base de fonctions dites « orthogonales » - des fonctions qui, dans une représentation graphique, se croisent systématiquement à angle droit. Ce sont ces signaux simples qui portent le nom d’harmonique. À chaque timbre sonore correspond ainsi un « spectre », qui énumère la fréquence des diverses harmoniques requises pour le reconstruire, en précisant l’amplitude et la phase de chacune d’elle. L’importance épistémologique de cette découverte ne saurait être surestimée : elle détermine un principe unificateur pour tous les sons du monde, des plus simples aux plus élaborés, qui permet non seulement de les comparer entre eux, mais également de les reconstruire au moyen de signaux élémentaires, en un principe connu sous le nom de « synthèse additive ».
Malgré l’importance de cette théorie, le nom de Fourier est resté longtemps très discret dans l’histoire des sciences (son nom n’apparaît pas dans l’édition 1974 de l’Encyclopedia Universalis). La fin du XXe siècle a transformé cette situation du tout au tout : les développements requis par l’informatique et les télécommunications au niveau de tout ce qui concerne le traitement de signal ont entraîné un regain d’intérêt considérable pour ce travail, au point que certains auteurs n’hésitent pas à dire que Fourier rejoindra, et dépassera probablement très bientôt, Newton, Maxwell et Einstein au panthéon des grands théoriciens de la physique. Les applications du principe de Fourier dépassent largement la musique : on les retrouve en optique, en traitement d’image – le format jpeg en est directement issu, en analyse de motif et de forme, en cosmologie, en planétologie, en acoustique, en optique… Loin d’être une découverte locale et anecdotique, il propose un mode de description du réel extrêmement puissant, littéralement basé sur un vocabulaire d’ondes, et qui possède la propriété unique et singulière de pouvoir décrire et produire une chose et son contraire. Selon que les interférences de plusieurs trains d’ondes sont constructives ou destructives, on peut rendre compte, selon les ondes considérées, du son et du silence, et on fabrique les deux, comme dans les casques d’écoute à réduction de bruit active; on rend compte de la lumière et de l’obscurité, comme en témoignent les franges d’interférence des bancs optiques ; on rend compte de la matière et du vide ; et ainsi de suite.
De très beaux instruments scientifiques ont été fabriqués pour analyser les timbres sonores selon ce nouveau modèle. On pense à l’extraordinaire tonomètre à 670 diapasons, ou encore au fréquencemètre à sphères résonantes, tous deux construits par Rudolph Kœnig au XVIIIe siècle. L’image d’un timbre décomposable en sons élémentaires, comme la lumière en couleurs primaires, devient le modèle prééminent en acoustique et en musique. Il conduit au cours des décennies suivantes à une forme d’unification des notions d’harmonie, d’accord, de timbre et de mélodie, progressivement considérées comme les versions d’un même phénomène, essentiellement différenciées par la temporalité de leur déroulement. L’idée d’utiliser le principe spectral comme base de composition sonore ou musicale s’est toutefois fait attendre ; si l’on en trouve les prémisses dans les travaux de Xenakis, Ligeti, Stockhausen et plusieurs autres, le terme de « musique spectrale » n’apparaît qu’en 1979. Son importance dans le cadre de notre exposé provient du fait qu’il constitue ni plus ni moins qu’une nouvelle version de la connexion harmonique, réinterprétée à la lumière de la science contemporaine : c’est précisément vers cette époque, entre 1960 et 1980, que le théorème de Fourier est en quelque sorte rentré en grâce, se positionnant comme un modèle cosmologique fondamental de description du monde. Dans une logique de méthodologie scientifique, aucune démonstration rigoureuse ne pourrait prétendre lui donner un statut cosmologique en tant que tel, comme c’était le cas pour l’ancienne musique des sphères, mais les analogies qui s’établissent entre la musique spectrale et le modèle cosmologique des harmoniques ne peuvent être rapidement écartées.
De telles analogies se retrouvent d’ailleurs tout au long de la période qui nous sépare de la naissance de la science contemporaine, que l’on peut situer approximativement au moment de la publication du Mysterium Cosmographicum de Kepler, au tournant du XVIIe siècle. Plusieurs auteurs pourraient prétendre symboliser ce moment, mais Kepler occupe une place particulière : personnage hybride, ancré dans le cosmos antique et précurseur de la cosmologie contemporaine, il a vu sa carrière se dérouler à cheval sur l’astrologie et l’astronomie. Il a pu finaliser les trois lois qui portent son nom, et qui décrivent les caractéristiques de tout objet en orbite, par la reprise d’un modèle antique insensé du point de vue scientifique, selon lequel toutes les planètes chantent ; plus elles sont loin du Soleil, plus leur voix est grave. Si l’on n’entend pas leur chant, c’est que nous y sommes habitués, contrairement aux nouveau-nés, qui, terrifiés par leurs voix, crient et pleurent sans cesse. C’est en tentant d’accorder le chant des planètes que Kepler a dérivé la loi qui relie leurs périodes respectives à leur distance au Soleil. La tonique de sa nouvelle harmonie des sphères a été fixée par le chant de la Terre, dont l’orbite, légèrement elliptique, ne parcourt musicalement qu’un intervalle d’un demi-ton. Ce demi-ton doit, selon l’astronome, correspondre aux notes mi et fa, puisque la destinée des humains se résumait aux deux mots misere fames – misère et famine. Malgré cette origine dépourvue de tout fondement scientifique, les lois de Kepler restent aujourd’hui aussi valides qu’au XVIIe siècle. Elles peuvent être directement dérivées des lois de Newton, et sont utilisées à chaque fois qu’un objet est mis en orbite.
Kepler est le premier d’une série d’auteurs qui ont tenté, à partir des connaissances de leur époque, de développer de nouvelles versions de l’harmonie de sphères, progressivement de plus en plus affirmées du point de vue scientifique, par lesquelles la notion d’harmonique est progressivement devenue essentielle du point de vue cosmologique. Tout se passe comme si, malgré les réfutations implacables de l’ancien modèle, les astronomes et les astrophysiciens ne pouvaient se résoudre, malgré les injonctions rationnelles et objectives de la science moderne, à imaginer un univers sans harmonie ou sans musique, et ce à toutes les échelles. Cette persistance soulève un bon nombre de questions, dont plusieurs ne sont pas totalement élucidées, sur l’importance de l’analogie musicale dans la description du monde. Les théories de Louis de Broglie et de Jean-Pierre Luminet nous en fourniront des exemples, situés ceux-là aux deux extrémités des échelles du cosmos.
Au niveau du microcosme, c’est au début du XXe siècle que le physicien français Louis de Broglie s’est attaqué à la détermination des lois qui fixent les distances entre les orbitales électroniques et le noyau atomique, dans le cas précis de l’atome d’hydrogène. La réponse lui a été fournie par une analogie musicale directe : en supposant, pour des raisons théoriques, une forme sphérique pour les orbitales, et en associant à chaque électron une « onde porteuse » sphérique de longueur d’onde définie, il a déterminé que les seules orbitales permises étaient celles qui correspondaient à un nombre entier de longueurs d’ondes, exactement comme dans le cas des fréquences émises par la corde vibrante du monocorde, ou de tout instrument de musique. Cela lui a permis de prédire le rayon de toutes les orbitales avec une précision inégalée.
Au niveau du macrocosme, l’astrophysicien français Jean-Pierre Luminet a récemment proposé un nouveau modèle cosmologique qui suppose un Univers bien plus petit que celui du modèle standard. L’analyse de la répartition dans l’espace du rayonnement cosmologique fossile, vestige des formidables rayonnements émis juste après le Big Bang, a révélé que certaines longueurs d’onde, les plus grandes du spectre, étaient pratiquement absentes alors qu’elles devraient être largement majoritaires. Cela lui a suggéré une hypothèse inattendue. Ces longueurs d’ondes correspondent aux premières harmoniques. Si elles manquent, c’est que l’Univers n’est pas assez grand pour permettre aux ondes correspondantes de se propager. Les dimensions du cosmos doivent alors être déterminées par rapport aux harmoniques suivantes, de longueur d’onde plus courtes, ce qui laisse supposer un Univers de rayon considérablement plus petit que les 54 milliards d’années-lumière actuellement dérivées du modèle standard. Si nous le voyons plus grand qu’il ne l’est, c’est qu’il se réfléchit multiplement sur lui-même, comme dans une chambre des miroirs dont la forme serait dodécaédrique. Cette hypothèse entraîne une conséquence étonnante : en regardant dans une direction précise, il devrait être possible de contempler le reflet de notre propre système solaire – ou plutôt, celui du lieu de notre système solaire avant sa naissance, tel qu’il apparaissait il y a des milliards d’années.
À côté de ces trois exemples, on trouve encore aujourd’hui un grand nombre d’ouvrages, scientifiques, astronomiques ou ésotériques, faisant référence à la musique des sphères. Au niveau cosmologique, la redoutable théorie des cordes, énoncée dans les années 80, postule que les particules fondamentales de l’univers ne sont plus ponctuelles. Elles se présentent sous la forme de cordes infinitésimales dont les modes de vibration, qui se déroulent dans un espace à à onze dimensions, correspondent aux particules que nous observons. Première théorie à unifier les quatre forces fondamentales aujourd’hui connues, elles est malheureusement invérifiable par l’expérience. Elle se heurte à des obstacles infranchissables qui la confinent pour le moment au statut d’hypothèse mathématique. Il n’en reste pas moins que malgré cette complexité, elle présente d’étonnantes similitudes avec les théories antiques, et qu’elle a occupé une très grande partie du temps de recherche des physiciens et des astrophysiciens pendant les dernières décennies.
De son côté, le domaine de l’architecture voit régulièrement émerger, tant chez les étudiants que chez les chercheurs ou chez les praticiens, des projets basés sur telle ou telle forme musicale, comme si le lien qu’entretiennent les deux domaines restait toujours privilégié. En une phrase approximative mais parlante, on peut dire que l’architecture est au temps ce que la musique est à l’espace. On ne compte plus les auteurs qui, de Frank Lloyd Wright à Hassan Fathy, en passant par Gœthe, Listz, Valéry, Le Corbusier, et tant d’autres, ont associé d’une façon ou d’une autre les couples espace/architecture et temps/espace, décrivant l’architecture comme une musique gelée, ou la promenade architecturale comme une symphonie musicale avec son ouverture, ses mouvements, ses crescendi et ses andante. Toutefois, si des auteurs comme Valéry ou Le Corbusier évoquent directement la référence au corps humain, c’est sans référence cosmologique aucune ; mais les proportions humaines déterminent toute architecture, ou toute musique, comme une petite cosmologie, spatialement ou temporellement définie, au sein de laquelle se disposent des éléments selon un arrangement particulier et unique : là où l’architecture dispose et organise la matière dans l’espace, et l’espace dans la matière, et se consacre à concevoir les limites qui les séparent, la musique organise et dispose les sons dans le silence et les silences entre les sons, et travaille à concevoir les transitions entre les deux.
Bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples : le rapport au temps de l’architecture et le rapport à l’espace de la musique sont essentiels à l’appréciation des deux formes d’art. Ce qui nous importe ici est que toute forme d’organisation connue peut être utilisée pour composer une œuvre architecturale, ou une pièce musicale ; et que toute forme d’organisation nouvellement découverte est susceptible d’entraîner l’apparition de nouvelles formes musicales ou architecturales. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la géométrie fractale. Introduite dans les années 70, elle a permis de caractériser géométriquement des formes et des configurations jusque là réticentes à toute réduction géométrique, telles que celles des nuages ou des montagnes. Ce faisant, en intégrant ces objets dans la grande famille des objets ordonnés pour la conscience humaine, elle a complètement transformé le sens même des termes « ordre » et « organisation », tout en se dotant d’un sens nouveau et spécifique pour le terme « harmonique ». À la suite de ce changement de paradigme, dont les répercussions se sont fait sentir dans tous les domaines et à toutes les échelles, on a vu apparaître des œuvres architecturales ou musicales directement conçues d’après un modèle fractal – un écho cosmologique qui, même dans le monde contemporain, scintille encore des des principes primordiaux qui fondaient les cosmologies antiques.
Le passage de l’harmonie des sphères à la science contemporaine comme modèle de description du monde s’est accompagné de la disparition de la notion d’harmonie comme opérateur cosmologique, au profit de celle d’harmonique. Les deux concepts présentent toutefois d’étonnantes similitudes au niveau de leurs rôles respectifs. Comme l’harmonie, l’harmonique est une messagère, qui nous transmet des informations importantes sur l’état de mondes inaccessibles, telles que les orbitales atomiques ou les strates les plus reculées de l’univers observable. Comme elle, elle joue un rôle ordonnateur : toute composition à base d’harmoniques présentera des régularités ou des rythmes de nature variée, qui la distingueront d’une composition aléatoire. Comme elle également, elle permet une description unifiée du monde à partir d’objets simples et limités en nombre. Par une observation rétroactive, on remarquera que les épicycles, qui dans le système solaire de Ptolémée et de ses prédécesseurs, et comme dans le système de Copernic, qui ne s’était pas résolu à abandonner le cercle comme figure fondamentale du cosmos, tentaient de rendre compte du mouvement des planètes au moyen des seuls cercles, correspondent exactement à la définition des harmoniques contemporaines. Ainsi se dégage une nouvelle connexion entre les théories anciennes et modernes qui manifeste l’équivalence profonde entre les notions d’orbite, d’onde et de rythme, et selon laquelle tout phénomène descriptible par l’un de ces trois concepts peut être également décrit par les deux autres.
C’est de ces considérations qu’est né, il y a plusieurs années déjà, le programme Point [d’] origine. L’idée initiale consistait à explorer, au moins du point de vue théorique, la possibilité d’une transposition entre une forme architecturale et une forme musicale. Elle proposait une version contemporaine de l’harmonie des sphères, repensée à la lumière des modèles que propose la science actuelle dans les domaines de l’astrophysique, de la musique et de l’acoustique. L’objectif était de produire soit une forme architecturale à partir d’une forme musicale, soit l’inverse, avec une condition que ne remplit aucune des transpositions similaires que nous avons rencontrées, à savoir celle de la réversibilité : le passage d’un domaine à l’autre, comme le passage inverse, devait se faire sans perte d’information, et permettre de reconstituer intégralement la forme originale.
Cette contrainte s’est révélée très forte. Elle impliquait l’emploi de descriptions strictement formelles, idéalement réductibles à des données numériques et à des relations mathématiques. Elle a conduit, après plusieurs tentatives, à l’emploi d’un objet mathématique particulier appelé « harmonique sphérique », conceptuellement simple, mais dont la manipulation demande des compétences assez avancées.